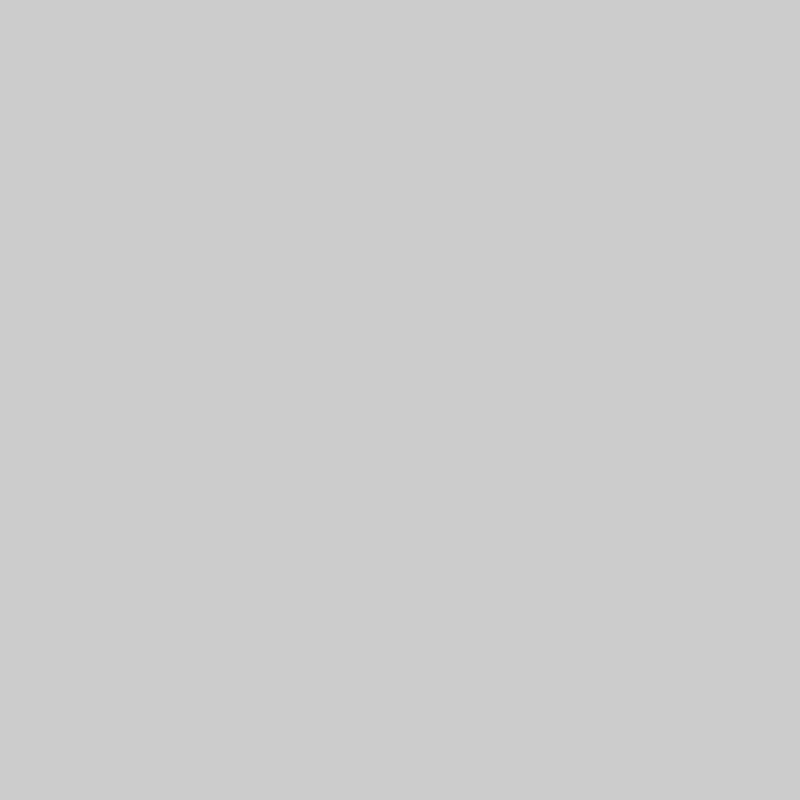“On ne voit pas la réalité comme elle est,
mais tels que nous sommes”
Le Talmud
“Un voyage d’hiver”
Le nord de l’Angleterre, tel un Royaume-Désuni, Berlin, puis l’Allemagne orientale, enfin Lodz, Varsovie, et aussi une saison en Lorraine… Depuis plus de vingt-cinq ans, à la façon d’un compagnon, Stéphane Duroy effectue inlassablement son tour d’Europe.
Un voyage au lent cours (plus de dix ans en Angleterre, plus de onze à Berlin) dans des villes et des campagnes blessées où le présent se conjugue au passé. Nulle brusquerie du regard, ici : il s’agit d’un voyage dans le temps qui laisse à son auteur toute latitude pour qu’il décide du sens de sa démarche.
Ce n’est pas un hasard si Stéphane Duroy a rôdé si longtemps à l’ombre du mur de Berlin, cicatrice barbelée du nazisme.
Pas un hasard non plus si, après le 9 novembre 1989, il a mis le cap sur la Pologne des camps, et si, enfin, comme poursuivant une chronologie inverse, il a bouclé ce voyage d’hiver du côté de Verdun.
Lequel d’entre nous aurait pu imaginer une histoire qui commencerait dans les tranchées de 14-18, se poursuivrait à Auschwitz, foncerait tête baissée contre le rideau de fer de la “guerre froide” et déboucherait enfin aujourd’hui sur l’explosion du terrorisme ?
Stéphane Duroy s’interdit tout pathos. Les rails qui conduisaient aux chambres à gaz luisent, paisibles et désertés, sur fond de broussailles. Le Staline des goulags n’est plus qu’un pantin qui s’agite sur une vieille affiche blafarde. C’est parce que le photographe garde ses distances avec les fantômes du passé qu’ils resurgissent soudain si fort en filigrane, à la lumière d’un présent indifférent.
Tous ces visages, tous les passants qui hantent cette Europe du silence sont comme prisonniers d’un quotidien couleur de muraille. Héritiers involontaires d’une histoire qui ne leur a jamais appartenu. Mais Stéphane Duroy les comprend en photos. Son objectif les libère en leur ouvrant les pages d’un album de famille qui est aussi le nôtre : la vie est là et c’est comme ça.
Un bien sombre tableau ? Sans doute, mais embelli par un regard lumineux sur le monde, tel qu’il est. En noir et blanc ou en couleurs, ces photos ont une aura identique. Ici, une pellicule de neige donne à la noirceur des paysages et des rues une réverbération d’aube. Là, des roses fanées, des pourpres de vieux rideau, des crépuscules de bleus ou de verts de gris vibrent en sourdine, comme des braises sous la cendre.
Enfin, lorsque son périple devient trop éprouvant, que le poids de tout ce qu’il a vu menace de le déséquilibrer, oui, fréquemment, le voyageur quitte soudain le sol. S’envole vers une autre dimension.
Cet homme absolument seul qui marche dans cette rue absolument vide, c’est sûrement Godot. Plus loin, sous un ciel de coton gris, une route s’étire, si rectiligne qu’elle semble venue d’ailleurs pour aller vers nulle part : mais dans le lointain, deux phares luisent comme des yeux jaunes. Et, à Lodz, que dire de ce théâtre béton des années soixante dont le hall clinquant tente de copier les fastes d’un très vieil Opéra ? Et puis voici les enfants. De dos, grosse comme une montgolfière, la tête d’un bébé qui contemple l’avenir à travers une vitre. Ou encore, plantés au beau milieu d’une avenue menaçante et sinistre, un coquelicot et un bleuet se tiennent par la main : non, ce sont deux gamins de Berlin qui jouent, en se moquant bien du reste.
Kafka confia un jour à son disciple Gustav Janouch : “On photographie des choses pour se les chasser de l’esprit. Mes histoires sont une façon de fermer les yeux.”
Oui, il convient d’ouvrir mais aussi, parfois, de fermer les yeux pour mieux faire parler ces images.
Jean-Paul Gibiat